Mondiaux contre locaux, Superclasse contre déclassés, Touristes contre vagabonds : la globalisation est-elle un néocolonialisme?
Dossier préparé par Raphaëlle Lévy
En 1885, Jules Ferry n’imaginait sans doute pas la chaîne de drames et de souffrances qu’engendrera, du nord au sud et du sud au nord et pour plusieurs siècles, son fameux : « Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouvertement qu’en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures […] [Remous sur plusieurs bancs à l’extrême gauche] parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont un devoir de civiliser les races inférieures (…) Les colonies sont, pour les pays riches, un placement de capitaux des plus avantageux. Au temps où nous sommes et dans la crise que traversent toutes les industries européennes, la fondation d’une colonie, c’est la création d’un débouché »[1]
La gauche française a heureusement abandonné depuis longtemps sa rhétorique sur les « races inférieures ». Mais ayant troqué la nation et l’idéal de justice sociale contre la foi dans le « Progrès »[2] et son universalisme (désir d’un ordre du monde) contre la mondialisation (soumission au désordre du monde) elle a aisément recyclé son sans-frontiérisme dans l’économie globale et une certaine interprétation littéraliste des droits de l’homme.
« Les classes dirigeantes, qui modèlent l’opinion, sont encore davantage coupées de l’environnement social et écologique : elles ne se déplacent qu’en voiture, vivent dans des circuits de transports – aéroports, quartiers d’affaires, zones résidentielles – qui les mettent à l’abri du contact avec la société. Elles minorent évidemment les problèmes dont elles n’ont qu’une représentation abstraite. Quant à ceux qui sont d’ores et déjà confrontés aux désordres sociaux et écologiques de la crise en cours – pauvres des banlieues [et de nos régions rurales, ndla] occidentales, paysans d’Afrique ou de Chine, employés des maquiladoras[3] américaines, habitants des bidonvilles de partout -, ils n’ont pas voix au chapitre. » constate Hervé Kempf.[4]
« L’Occident a gagné, il a imposé son modèle ; mais par sa victoire même, il a perdu. Sans doute faudrait-il introduire une distinction entre l’Occident universel, diffus, implicite, qui a investi l’âme de toutes les nations de la terre ; et l’Occident particulier, géographique, politique, ethnique, celui des nations blanches d’Europe et d’Amérique du Nord. C’est ce dernier qui se trouve aujourd’hui dans l’impasse. Non parce que sa civilisation aurait été dépassée par celle des autres, mais parce que les autres ont adopté la sienne, la privant de ce qui faisait jusqu’ici sa spécificité et sa supériorité » explique Amin Maalouf[5].
La mondialisation, largement réalisée par des hommes de la gauche française après 1983 (capitaux, marchandises et individus sans frontières) n’est plus l’expression de la colonisation d’un pays par un autre, d’un continent par un autre, ou d’une race par une autre. Elle ressemble à l’exploitation d’une grande partie de la population du monde du nord comme du sud (tous ceux que le géographe Christophe Guilly appelle « les perdants de la mondialisation ») par une super-classe mondialisée (les « gagnants ») qui impose sa tutelle idéologique et économique aux premiers où qu’ils soient.
En observant sur toute la planète qui sont ces gagnants et les perdants de la globalisation de l’économie et du droit, on voit ainsi apparaître une ligne de fracture elle-aussi transnationale : entre une classe mondialisée et cosmopolite qui contrôle l’essentiel des flux mondiaux de marchandises, de capitaux et d’information, impose ses codes, ses langages et profite de l’ouverture mondialiste, et une humanité (les trois quarts) qui en souffre économiquement, culturellement et socialement – notamment celle du sud contrainte par exemple de quitter ses terres, ses villages, ses traditions pour aller fabriquer à bas coût dans les « ateliers de la sueur » et sans droits, ce que celle du nord, les consommateurs prolétarisés et infantilisés devront absorber en continu, épuisant à leur tour ce qui reste de leur Etat-providence.
Cette élite mondialisée contrôle - avec l’aide de l’administration globale : notamment l’OMC, du FMI, de la Banque Mondiale, de la Commission européenne, des Banques centrales, des banques d’affaires, les think-tanks et ONG - la mondialisation de l’économie, de la finance et de l’information, s’y enrichit sans partage, professe et réalise à cette fin l’impératif moral et culturel du capitalisme de consommation : abattre toutes les frontières, limites, distinctions et hiérarchies. L’héritage des Lumières et les principes républicains sont ici convoqués mais atteints de la même maladie du déracinement :
- la liberté (Rousseau, Kant, Montesquieu) dévoyée en licence (les noces d’Hayek et de Sade),
- l’égalité (donc la justice) dévoyée en interchangeabilité générale (fin de l’altérité, « l’Homme sans dialectique » : homme/femme, père/fils, maître/élève, bien/mal, décent/indécent, juste/injuste, national/étranger etc.). Voilà le « tout-est-possible » (slogan nihiliste nazi qui, selon Hannah Arendt, a juste démontré que tout peut être détruit) dans sa dangereuse marche créant et entretenant (par le divertissement, la publicité, le marketing)[6] l’insatisfaction permanente et l’infantilisation nécessaires du consommateur.[7]
- la fraternité dévoyée en communautarisme « qui est la négation même de l’idée de citoyenneté »[8].
- Dans les pays en développement : elle impose un messianisme occidental en faveur du tout-marché, de la « bonne gouvernance » démocratique et du respect des droits fondamentaux, avec des accents paternalistes néocoloniaux ;
- Dans les pays occidentaux : elle s’incline devant des organes non-démocratiques et elle s’incline devant la culture et la religion des derniers arrivés via le communautarisme en renonçant à l’assimilation et invitant au « compromis réciproque » entre culture européenne et culture des immigrés.
Dans une interview au Figaro[9], Hervé Juvin[10] critique la prétention universaliste de l’Occident moderne : « C'est le grand débat des Lumières et de la prétention au règne universel de la raison. L'idée que nous, Occidentaux, Européens, Français, Américains, aurions mis en place depuis les Lumières un modèle idéal de vie pour l'humanité, entre la croissance économique et la révolution industrielle, la démocratie et les droits de l'homme. Je ne le crois absolument pas. Je crois que d'autres sociétés qui vivent avec d'autres lois, d'autres mœurs, selon d'autres règles, ont su offrir les conditions du bonheur à leurs habitants. Je ne souscris pas à l'idée selon laquelle notre régime politique, notre musique, notre art, notre culture seraient le point d'aboutissement de l'humanité vers lequel tous les autres peuples devraient converger. Il y a une voie chinoise, une voie hindoue, des voies africaines, qui feront des sociétés équilibrées et heureuses, sûres de leurs identités, différentes de la voie américaine ou de la voie européenne. »
Un droit-de-l’hommisme messianique entend donc étendre à tous les pays occidentaux et aux pays « en développement » une lecture littérale et donc fondamentaliste des droits de l’Homme. Ceux-ci, qui sont pourtant historiquement et géographiquement situés, sont frappés par la maladie du déracinement, qui rend fou ou dépressif tout ce qu’elle déracine : l’économie, la finance, le pouvoir, la religion, le droit, l’individu... Les droits de l’Homme sont ainsi interprétés non plus au regard du cadre référentiel donné, d’une civilisation ou d’une culture particulière, mais au regard de l’individu abstrait, interchangeable, pouvant aller partout et ne venant de nulle part[11].
Cette foi est propagée jusque dans les pays en développement par tous les instruments modernes : médias, sciences sociales, institutions de la mondialisation.
- Les sciences sociales et les médias : les « Gender Studies » (études de genre[12]) ont ainsi pris une part prépondérante dans les programmes occidentaux d’aide aux chercheurs africains. Des milliers de Centres de recherche indépendants (les fameux « Think Tanks », près de 5500 recensés, la plupart situés en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest) emploient, assurent la notoriété et gagnent ainsi la fidélité d’universitaires qui dans les pays du tiers monde connaissent un chômage important. Leur action rejoint celle des grandes ONG comme Human Right Watch, Amnesty International ou Transparency International dont les rapports annuels sont toujours attendus. Comme les rapports classant les « performances » économiques des pays pour les mettre en concurrence, ces rapports sont exploités dans les médias champions de la mondialisation des marchés et des droits de l’Homme[13].
- Les institutions mondiales : les crises d’endettement à répétition des pays en développement sont des moyens de pression puissants pour imposer à ces pays non seulement l’ouverture de leurs économies et de leurs matières premières aux firmes multinationales mais aussi une certaine lecture des droits de l’Homme, dans le cadre des plans de « développement » ou des « prêts d’ajustement structurels » mis en œuvre contre le « sous-développement » par la Banque Mondiale en parallèle à la ligne de crédit du FMI pour assurer l’application des réformes exigées. Les Nations Unies, à travers leurs agences spécialisées ou les organisations sœurs en charge du développement des pays du tiers monde vont introduire des approches des questions de pauvreté, de développement du « capital humain », d’égalité des genres, de lutte contre les discriminations, en phase avec la mondialisation néolibérale.
- L’exemple de la loi ougandaise sur l’homosexualité sanctionnée par la suspension des aides. En décembre 2013, l’Ouganda a adopté une loi condamnant les relations sexuelles entre personnes du même sexe, le « mariage » homosexuel, parle « d’homosexualité aggravée » pour les viols, les actes sexuels avec des mineurs ou des personnes handicapées, le harcèlement sexuel d’une personne du même sexe, le fait pour une personne porteuse du virus VIH d’avoir un rapport homosexuel. Le projet initial prévoyait la peine de mort pour ce type d’actes mais la loi définitive prévoit « seulement » la prison à vie. Le principe ou la sévérité de la peine peut être critiquable, mais là n’est pas la question. Ce qui est extraordinairement révélateur de la tutelle idéologique et politique des occidentaux, c’est la nature et l’ampleur de leur réaction. Cette loi a été qualifiée d’ « odieuse » par le président américain Obama et d’ « atroce » par son Secrétaire d’État John Kerry, qui l’a comparée aux lois anti-juives de l’Allemagne des années 30. William Hague, le ministre britannique des Affaires étrangères a, lui, parlé de loi « profondément affligeante et décevante ». Ingérence caractérisée, ce ne sont encore que des paroles politiques répondant à la parole législative du parlement ougandais. L’ingérence la plus grave sur ce pays africain qui a beaucoup souffert[14], c’est la suspension immédiate par pays riches de leurs programmes d’aide à l’Ouganda : des centaines de millions d’euros gelés par la Suède, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, la Grande-Bretagne et les États-Unis, ainsi que par la Banque Mondiale qui a suspendu en février 2014 ses prêts en faveur du secteur de la santé ougandais.

3) La colonisation par l’endettement et la corruption
En 1982, les pays du tiers monde sont pour beaucoup gravement touchés par l’endettement et ne peuvent rembourser les dettes contractées auprès d’autres Etats ou grandes banques internationales. Pour obtenir un rééchelonnement de leur dette extérieure, leurs créditeurs publics et privés leur imposent, via le FMI (siège à Washington et les Etats-Unis en sont le premier actionnaire) qui les représente, des réformes néolibérales sans précédent : suppression des subventions aux produits de base alimentaires ou énergétiques, réduction des dépenses publiques (y compris des services sociaux d’éducation et de santé), augmentation des taux d’intérêt domestiques pour mieux rémunérer l’épargne, privatisation des entreprises publiques les plus rentables.Des firmes internationales vont alors s’approprier, souvent sous forme de concession et de monopoles, les secteurs les plus juteux : télécommunications, finance et tourisme, non sans avoir versé des pots-de-vin aux dirigeants de l’Etat concerné. L'Afrique aujourd'hui paierait en outre chaque année (en paiement des intérêts sur prêts) au FMI et à la BM cinq fois plus qu'elle ne reçoit d'aides au développement sous forme de prêts etc. Les conséquences sur les niveaux de vie de ces pays seront dramatiques, notamment en Afrique subsaharienne et en Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, Pérou) ainsi que dans certains pays d’Asie (Philippines, Pakistan, Indonésie, Bangladesh).
Dans la plupart des cas, une grande partie de l'argent prêté à ces pays ne contribue pas au développement mais est retournée aux sociétés étrangères privilégiées et alimenté les réseaux de corruption au nord comme au sud, sous forme de commissions et rétro-commissions. Pour l’essentiel, ces prêts étrangers seraient donc, en fait, des subventions aux sociétés qui sont liées d’intérêt avec les dirigeants de l’État emprunteur. Cette connivence est désignée sous le nom de « corporatocratie ». Les organismes accusés de participer à ce « néo-colonialisme » sont donc la Banque mondiale, mais aussi l’Organisation mondiale du commerce, le G8 et le Forum économique mondial, sans oublier certains « pays riches » à commencer par les États-Unis et ses multinationales.
La position extraordinaire de pouvoir des super-créanciers permet aussi d'exiger de « l'Etat sujet » l'établissement de bases militaires, un vote favorable aux Nations unies, une loyauté politique en général, l'accès à bon marché à d'éventuelles richesses pétrolières et autres ressources naturelles…[15]
Le risque se profile d’une nouvelle grande crise de la dette semblable à celle de 1982 et des fonds d’investissements du nord lorgnent sur les pays (Côte d’Ivoire, Ethiopie, Rwanda, Sénégal par exemple) qui vendent sur les marchés financiers des pays industrialisés des titres de leurs dettes publiques (7 milliards vendus en 2014) promettant un rendement de 6 à 8% même si les risques sont élevés. Or, avec la chute du prix des matières premières (pétrole, argent, cuivre, coton, caoutchouc) les Etats concernés pourront difficilement rembourser leurs créanciers, donc ce sont les populations qui vont encaisser le coup[16] et l’ingérence qui va s’accentuer.
4) La colonisation par le libre-échange intégral
Le libre-échangisme est un système par lequel « on fait subventionner les riches des pays pauvres par les pauvres des pays riches » expliquait un ancien conseiller économique de M. Thatcher, Allan Walters. On peut se demander vingt ans plus tard si ce n’est pas même un système qui a conduit à la mise à mort lente des classes moyennes des pays développés, accru la pauvreté partout (sauf une partie des paysans chinois) et enrichi une petite minorité mondialisée et barricadée.Voilà le grand mensonge de la prétendue « mondialisation » : elle est extrêmement profitable pour une petite caste de gens mobiles, déracinés et intégrés à son fonctionnement et à ses profits (« les mondiaux ») et elle marginalise, affaiblit voire fait souffrir (économiquement, culturellement, socialement, humainement) les trois quarts de la population de la planète (« les locaux »). La richesse est mondiale, les misères sont locales. Tentons un rapide recensement.
a) Les perdants des pays riches
- Baisse des revenus. Depuis quinze ans, les pays occidentaux ont vu leurs classes moyennes basculer dans les perdants du libre-échange. Leurs revenus ont décroché par rapport aux plus hauts salaires et aux revenus du capital. Selon le Prix Nobel Paul Krugman, le salaire réel médian a chuté de 12% depuis 1973 (aux Etats-Unis). Dans le même temps, celui des 1% les plus riches doublait et que celui des 0,1% des super-riches quintuplait. Pouvoir acheter son alimentation 20% moins cher chez Lidl ou Colruyt ne compense pas la perte d’un salaire…
- Désindustrialisation et chômage. Le désastre industriel dans les pays développés est bien visible : -39% de salariés depuis 1999 au Royaume-Uni, -32% aux Etats-Unis, -20% en France et au Portugal, -12% en Espagne. En trente ans, la France a perdu plus de 2 millions d’emplois industriels, son déficit commercial est passé de 4 à 51 milliards (entre 2000 et 2010). Selon le Prix Nobel Maurice Allais, le libre-échange est à lui-seul responsable de 48% des destructions d’emplois[17] auquel il faut, pour la plupart des pays de la zone euro ajouter l’effet conjugué d’une monnaie unique longtemps surévaluée.
- Délocalisation. De 2006 à 2009, les entreprises du CAC 40 se sont séparées chaque mois de 1900 salariés français et augmenté dans le même temps de 7600 employés à l’étranger, notamment dans les pays émergents où les promesses de développement et le coût du travail sont forcément incomparables.[18]
- Gagnants et perdants en France. Après « Fractures françaises » (2012) c’est dans « La France périphérique » (2014) que le géographe Christophe Guilly expose son constat des perdants et des gagnants de la mondialisation. « Deux France se font face » et s’opposent sans se comprendre. D’une part, les gagnants de la mondialisation, bien intégrés à l’économie-monde car très qualifiés et investissant les grandes villes, mobiles, qui participent à la création des deux-tiers du PIB national, ou les banlieues intégrées qui ont un potentiel de reconversion assez important. D’autre part, les perdants de la mondialisation, la fameuse “France périphérique”, que l’auteur décrit comme “la France des plans sociaux” c’est-à-dire les populations sédentaires qui subissent directement la mondialisation de par leurs emplois peu qualifiés dans des industries ou des zones rurales en net recul, dont le malaise gagne les petites et moyennes villes. La métropolisation coupe ainsi la France en trois : l’ensemble des métropoles mondialisées et gentrifiées (boboïsées), par le modèle libéral de la société ouverte ; les banlieues ethnicisées, avec leurs valeurs traditionnelles au cœur de la mondialisation libérale ; la France périphérique des catégories populaires d’origine française et d’immigration ancienne. (Voir extrait joint)

b) Les perdants des pays pauvres
La part du revenu mondial actuellement allouée aux pauvres ne cesse de diminuer : 80% de la population mondiale ne possède que 22% de la richesse totale.L’économiste Jacques Sapir est l’un des rares à avoir tenté[19] un bilan chiffré du libre-échange pour les pays les moins avancés : sur les 22 milliards de dollars prétendument gagnés, il faut soustraire les pertes fiscales liées à la fin des droits de douane (60 milliards) et la réduction drastique des investissements (90 milliards), le bilan est donc plus que négatif en période de transition en tous cas : « La transition économique vers le libre-échange crée toujours des déséquilibres entre l’offre et la demande. L’ajustement prend du temps et les investissements industriels – au moins pendant la période de mutation – sont absents. » explique Sapir. Les paysans des pays pauvres privés soudainement de subventions ne peuvent se qualifier d’un jour à l’autre pour trouver une place à l’usine. De même que les ouvriers des pays riches dont l’usine est délocalisée se requalifient difficilement sur le champ pour être « employables » dans les services.
Les quelques gains de productivité générés par l’extension du libre-échange tombent essentiellement dans les mains du capital et non celles du travail.
Sous l’angle des gains par pays, une étude de la Banque mondiale révèle qu’il y a 517 millions de pauvres en moins depuis 1981 dans les pays pauvres, en fait Chinois pour l’essentiel :
- 208 millions de Chinois vivent avec moins de 1,25 dollar par jour aujourd’hui contre 835 en 1981, sans que l’on sache toutefois si c’est un effet bénéfique du libre-échange ou de la réforme agraire.
- Dans tout le reste de l’Asie du Sud, le nombre de pauvres n’a pas reculé : +36 millions de pauvres en Inde depuis 30 ans (rapporté à la population c’est cependant une baisse de 58 à 42%)
- En Afrique subsaharienne, le nombre de pauvres a bondi de 83% en vingt-cinq ans, sous l’effet conjugué du libre-échange et de l’explosion démographique.
Au total, le libre-échange mondial aurait permis de sortir de la pauvreté, bon an mal an, 200 à 300 millions de Chinois. On est loin de la « mondialisation heureuse » et triomphante annoncée par les élites économiques, intellectuelles et administratives mondialisées de l’Occident.
c) Les gagnants mondialisés
La convergence mondiale des niveaux de vie par la globalisation des échanges ne se réalise pas, sauf pour les très riches dont la fortune croît.Outre la minorité des « gagnants » parce que bien qualifiés, mobiles et intégrés à l’économie-monde (en France, un petit quart de la population, évoqué en a), il y a, au sommet de la hiérarchie des bénéficiaires de la mondialisation, ceux que l’on appelle les « super-riches », pour la plupart américains - 15 sur les 20 premières fortunes mondiales - avec une percée remarquable des super-riches des pays émergents – 17 des 50 premières fortunes mondiales selon Forbes). La fortune totale des 358 premiers milliardaires mondiaux équivaut aux revenus des 2,3 milliards les plus pauvres de la planète[20].
Le patrimoine cumulé des 1% les plus riches du monde dépassera en 2016 celui des 99% restants selon Oxfam[21]
En guise de conclusion : les nécessaires « limites à l’universel »
Extrait de l’interview d’Hervé Juvin (Figaro)[22]Q : Toutes les civilisations se valent, alors? Il n'y a pas de valeurs transcendantes, pas de droits de l'homme, pas d'universel… L'excision et le mariage forcée des petites filles est de même valeur que la quasi égalité hommes-femmes en Occident?
H.J : On a le droit de défendre un système de valeurs qu'on croit universel. Vous n'allez pas me faire dire que je suis pour la lapidation! Personne évidement ne peut souhaiter être mis en détention sans jugements, être torturé, etc… Mais on ne peut pas ne pas constater les désastres que produit l'imposition par le haut du modèle occidental dans les sociétés traditionnelles. L'universalisme européen et américain n'a abouti qu'à des champs de ruines: en Afrique, en Afghanistan, en Irak, en Libye… Et la folle course en avant du développement menace la survie de l'humanité ; au nom de quoi arracher ces millions d'hommes qui vivaient hors de l'économie du capitalisme, de l'accumulation, dans un équilibre avec la nature, pour les précipiter dans un système qui détruit les biens vitaux et les services gratuits de la nature?
Les motifs humanitaires masquent souvent des ingérences guerrières. Le «droit au développement» masque l'agression impitoyable de l'obligation de se développer, qui a fait des ravages en Asie et en Afrique. Les limites à l'universel ne sont pas seulement morales, mais physiques. La pénétration sans limites d'internet répand dans des populations entières des rêves qu'elles n'auront aucun moyen de satisfaire, à moins de faire exploser la planète. Il est impossible que 9 milliards d'humains vivent comme un Américain moyen. Ne pas se rendre compte de cela, c'est créer les conditions d'une humanité frustrée. Non seulement cet universalisme sème les graines du malheur, mais il est contre-productif: plus il essaie de s'imposer, plus il réveille des particularismes de plus en plus agressifs.
C'est là un point essentiel en géopolitique aujourd'hui: l'agression des modèles universels réveille les logiques de la différence politique. Je cite dans mon livre celui que je considère comme le plus grand ethnologue du XXème siècle Elwin Verrier, pasteur britannique marié avec une fille de la tribu des Muria: au bout de quarante ans passés à côtoyer les tribus indiennes, il a abouti à la conclusion suivante: laissons les vivre comme ils sont, hors du développement économique. Mêlons-nous de ce qui nous regarde: sagesse qui nous éviterait bien des bêtises! »
NOTES
[1] Il faut aussi citer Léon Blum : « Nous admettons qu'il peut y avoir non seulement un droit, mais un devoir de ce qu'on appelle les races supérieures, revendiquant quelquefois pour elles un privilège quelque peu indu, d’attirer à elles les races qui ne sont pas parvenues au même degré de culture et de civilisation » (Débat sur le budget des Colonies à la Chambre des députés, 9 juillet 1925)
[2] L’expression « On n’arrête pas le Progrès » semble justifier le renoncement collectif à accompagner le progrès scientifique et technique de tout progrès moral et social. Le progressiste n’est pas libéré mais soumis, non pas volontariste mais fataliste, donc « on n’arrête pas » la mondialisation, ni la roue de l’unification européenne « sans cesse plus étroite », ni le mouvement perpétuel des capitaux, des individus, des objets et des mœurs. Bref le croyant du « sens de l’Histoire » ne croit plus dans aucune forme de « gouvernement des Hommes » et prépare, après la « sortie du religieux » (Gauchet), celle du Politique, donc du peuple, et « l’administration des choses » qu’on n’arrêtera pas. Jusqu’au retour du refoulé et donc des identités, sous des formes peu agréables via l’Islam, le vote FN, le localisme etc.
[3] Usines d’assemblage situées le long de la frontière mexicaine
[4] Hervé Kempf, « Comment les riches détruisent la planète », Seuil, 2007
[5] Amin Maalouf, « Le dérèglement du monde », Grasset, 2009, où l’essayiste décrit le « Dérèglement intellectuel, caractérisé par un déchaînement des affirmations identitaires qui rend difficiles toute coexistence harmonieuse et tout véritable débat. Dérèglement économique et financier, qui entraîne la planète entière dans une zone de turbulences aux conséquences imprévisibles, et qui est lui-même le symptôme d’une perturbation de notre système de valeurs. Dérèglement écologique, qui résulte d’une longue pratique de l’irresponsabilité… L’humanité aurait-elle atteint son seuil d’incompétence morale ? » Pour l’auteur, « le dérèglement tient moins à une « guerre de civilisations » qu’à l’épuisement simultané de toutes nos civilisations, et notamment des deux ensembles culturels dont il se réclame lui-même, à savoir l’Occident et le monde arabe. Le premier, peu fidèle à ses propres valeurs ; le second, enfermé dans une impasse historique. »
[6] Père de la propagande et du marketing modernes, Edward Bernays, neveu de Freud réfugié aux Etats-Unis pendant la guerre, lu tant par les concepteurs de la propagande nazie et de la publicité contemporaine, révolutionne la communication de masse en montrant comment s’adresser à l’inconscient des foules, par exemple lorsque pour l’industrie du tabac il persuade les femmes de se mettre à fumer par la formule « Devenez les torches de la liberté ».
[7] Le petit enfant se rêve tout-puissant jusqu’à ce que le parent – ou à défaut plus tard et de manière violente la société et le droit pénal – ne lui pose des limites, comme les berges donnent au fleuve la force d’aller vite et loin, l’empêchant de se perdre en un étendue stagnante et marécageuse. Une société parricide ignore les limites, les berges et par suite la liberté et la justice ; elle produit des individus moins forts, moins libres, moins égaux, moins justes, de pauvres êtres désinstitués, déracinés, désaffiliés, noyés d’objets, d’images et de frustrations. Parce que la fuite éperdue dans l’illimité ne comble jamais la soif d’infini, elle l’en éloigne.
[8] Amin Maalouf, Op.cit
[9] « La fin de la mondialisation et le retour des identités », Le Figaro, 4/7/2014
[10] « La grande séparation, pour une écologie des civilisations », Gallimard, 2014
[11] « Les Droits de l’Homme sont traités comme un nouveau Décalogue, un Texte révélé par les sociétés « développées » aux sociétés « en voie de développement » et à ne laisser à ces dernières un autre choix que de « combler leur retard » et se convertir à la modernité des droits de l’homme et de l’Economie de marché réunis. C’est un fondamentalisme parce qu’il entend faire prévaloir une interprétation littérale des droits de l’Homme sur toutes les interprétations téléologiques mises en œuvre par les droits nationaux. Ainsi pris à la lettre, les principes d’égalité et de liberté individuelle qui sont à la base des droits de l’Homme peuvent faire l’objet d’interprétations folles. » Alain Supiot, Homo Juridicus, Seuil, 2005
[12] « Pas besoin d’être freudien pour identifier dans le mouvement d’effacement des différences la réalisation collective de la pulsion de mort » disait Philippe Murray
[13] Aux Etats-Unis, nombre d’associations, ONG, instituts, fondations, centres de recherche etc. employant des millions de personnes, ont une vocation internationale sur des régions, pays ou thèmes déterminés : sur 151539 ONG « thématiques », 23968 s’intéressent aux questions de développement et 5691 aux droits de l’Homme, la limite entre les deux thèmes étant poreuse.
[14] Des centaines de milliers de personnes tuées à l’époque du dictateur Amin Dada, soutenu par les Occidentaux, qui se remet aujourd’hui de ses années de lutte contre les terribles exactions de l’Armée de la Résistance du Seigneur (LRA) de Joseph Kohny,
[15]La spirale infernale est décrite par John Perkins dans ses « Confessions of an Economic hitman » (« Confessions d'un assassin financier - Révélations sur la manipulation des économies du monde par les États-Unis ») publié en 2004, livre autobiographique où l’ancien consultant explique que sa tâche de « tueur à gage économique » était est de « justifier et de permettre la conclusion par des États d'énormes prêts internationaux dont l'argent finira, déduction faite des sommes destinées à la corruption des élites locales, sur les comptes en banques de grandes sociétés d'ingénierie et de construction américaines. Les besoins en liquidités ayant été au préalable surévalués par ces consultants, l'État se révèle incapable de payer sa dette et en sujétion vis-à-vis du créancier.Repenti après avoir épousé une Colombienne en 1980, Perkins raconte ces méthodes « mafieuses » auxquelles il aurait participé.
[16] Pour desserrer l’étau économique et stratégique sur l’Afrique, le conseiller spécial de l’ONU Dr. Jeffrey Sachs exige que la dette africaine tout entière (environs 200 milliards de dollars US) soit effacée et recommande même que les nations africaines cessent de payer : « Le temps est venu de mettre fin à cette situation burlesque. Les dettes sont exorbitantes. S’ils refusent d’effacer les dettes je suggérerais l'obstruction ; vous le faites vous-mêmes. L’Afrique devrait dire : 'merci beaucoup mais nous avons besoin de cet argent pour répondre aux besoins des enfants qui meurent en ce moment, alors nous allons utiliser le service du paiement de la dette à des investissements sociaux urgents dans la santé, l’éducation, l'eau potable, le contrôle du SIDA et autres besoins. » Professeur Jeffrey Sachs, directeur du Earth Institute à l'université Columbia et conseiller économique spécial auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations unies (ONU).
[17] Maurice Allais, « La Mondialisation. La destruction des emplois et de la croissance : l’évidence empirique » Ed Juglar, 1999
[18] L’Expansion, n°757, « Les entreprises les plus patriotes », 2010
[19] Jacques Sapir, « Le vrai sens du terme. Le libre-échange ou la mise en concurrence entre les Nations », in David Colle (dir), « D’un protectionnisme l’autre. La fin de la mondialisation ? » Rapport Anteios 2009, PUF 2009.
[20] « Si ces 358 milliardaires les plus riches décidaient de conserver 5 millions de dollars chacun, pour se tirer convenablement d’affaire, et de donner le reste, ils pourraient doubler les revenus annuels de presque la moitié de la population du globe. Et les poules auraient des dents. » (Victor Keegan)
[21] La part du patrimoine mondial détenu par les 1% les plus riches était passée de 44% en 2009 à 48% en 2014, et dépasserait les 50 % en 2016 (…) En 2014, les membres de cette élite internationale possédaient en moyenne 2,7 millions de dollars par adulte. Le reste du cinquième (20%, ndlr) le plus riche de la population possède 46% du patrimoine mondial alors que 80% de la population mondiale ne se partagent que les 5,5% restant .





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg

 Ces considérations sont prégnantes dans les mouvements de droite, aussi bien classiques que populistes, même si ces derniers les assument beaucoup plus aisément, notamment en Grande-Bretagne avec UKIP, en Belgique avec le Parti Populaire, ou en Suède avec les Démocrates Suédois. Le fait de rompre un tel tabou et de rouvrir le débat sur la coexistence des civilisations facilite leur classement à l’extrême-droite. Pourtant, les problématiques issues de la coexistence ne sont pas liées aux pays de l’Europe blanche et chrétienne. Une enquête réalisée par Ipsos en 2011 révèle que ce phénomène touche aussi aux autres continents, il s’agit d’un phénomène inhérent à l’être humain, il est donc universel.
Ces considérations sont prégnantes dans les mouvements de droite, aussi bien classiques que populistes, même si ces derniers les assument beaucoup plus aisément, notamment en Grande-Bretagne avec UKIP, en Belgique avec le Parti Populaire, ou en Suède avec les Démocrates Suédois. Le fait de rompre un tel tabou et de rouvrir le débat sur la coexistence des civilisations facilite leur classement à l’extrême-droite. Pourtant, les problématiques issues de la coexistence ne sont pas liées aux pays de l’Europe blanche et chrétienne. Une enquête réalisée par Ipsos en 2011 révèle que ce phénomène touche aussi aux autres continents, il s’agit d’un phénomène inhérent à l’être humain, il est donc universel.
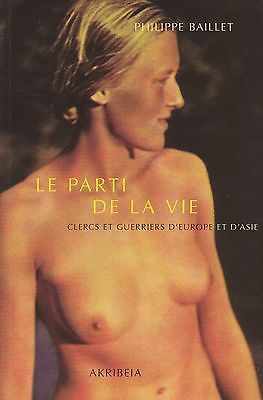 Le nom de Philippe Baillet ne vous est peut-être pas inconnu : il est le traducteur français de Julius Evola mais également l’auteur de nombre d’articles et de quatre autres livres. Le parti de la vie se compose justement de huit de ses études, certaines déjà publiées, d’autres considérablement enrichies par rapport à leur première version. Deux d’entre elles (sur Yukio Mishima et Giorgio Locchi dont un texte inédit en français se trouve d’ailleurs en annexe) sont inédites.
Le nom de Philippe Baillet ne vous est peut-être pas inconnu : il est le traducteur français de Julius Evola mais également l’auteur de nombre d’articles et de quatre autres livres. Le parti de la vie se compose justement de huit de ses études, certaines déjà publiées, d’autres considérablement enrichies par rapport à leur première version. Deux d’entre elles (sur Yukio Mishima et Giorgio Locchi dont un texte inédit en français se trouve d’ailleurs en annexe) sont inédites.


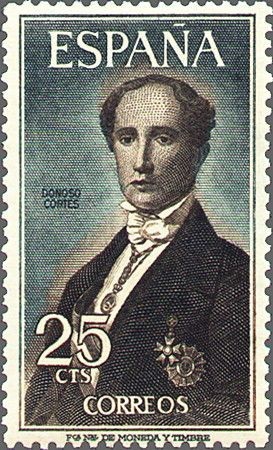
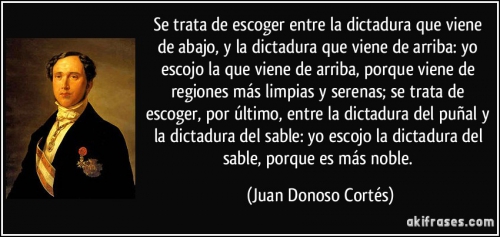

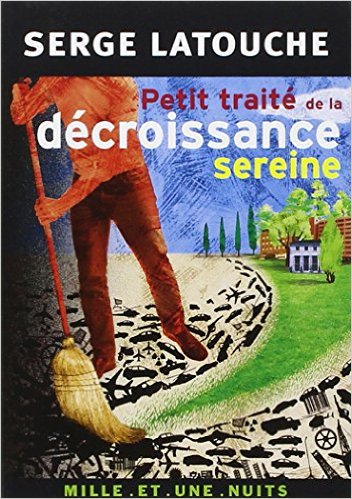 Il y a par conséquent une béance profonde fondamentale entre un soi-disant décroissant et le père de la décroissance en France. Serge Latouche prévient que « le “ bougisme ”, la manie de se déplacer toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus souvent (et pour toujours moins cher), ce besoin largement artificiel créé par la vie “ surmoderne ”, exacerbé par les médias, sollicité par les agences de voyages, les voyagistes et les tour-opérateurs, doit être revu à la baisse (6) ».
Il y a par conséquent une béance profonde fondamentale entre un soi-disant décroissant et le père de la décroissance en France. Serge Latouche prévient que « le “ bougisme ”, la manie de se déplacer toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus souvent (et pour toujours moins cher), ce besoin largement artificiel créé par la vie “ surmoderne ”, exacerbé par les médias, sollicité par les agences de voyages, les voyagistes et les tour-opérateurs, doit être revu à la baisse (6) ».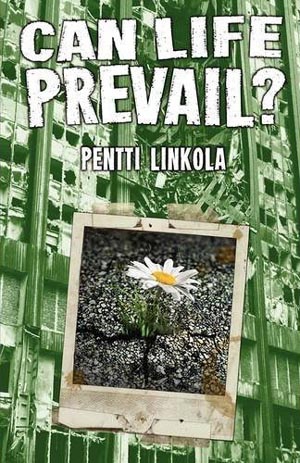 Il manque encore à la décroissance tout une dimension politique et stratégique. De nombreux décroissants raisonnent toujours à l’échelle de leur potager dans le « village global » interconnecté alors que la raréfaction croissante des ressources inciterait à envisager au contraire une société fermée, qu’elle soit nationale ou bien continentale dans le cadre de l’« Europe cuirassée » chère à Maurice Bardèche. En effet, « c’est […] bien une société de rupture qu’il faut ambitionner, annonce l’anarcho-royaliste français Rodolphe Crevelle, quitte à mépriser tous les clivages politiques antérieurs, quitte à paraître donquichottesque ou ridicule, ou rêveur, ou utopique… (13) ». Nourris par les traductions anglaises des écrits de l’écologiste radical finlandais Pentti Linkola dans lesquels se conjuguent écologie, décroissance et puissance militaire, Rodolphe Crevelle et son équipe du Lys Noir soutiennent une vision singulière de l’« écolo-décroissance ». « La préservation de l’Homme ancien “ dans un seul pays d’abord ”, ouvre la perspective d’un isolat forteresse assiégé parce que celui-ci constituera le mauvais exemple, le mouton noir du monde, un démenti à la “ fête ” globale planétaire (14). » Certes, « il faut […] convenir que l’autarcie est une question d’échelle. Elle est particulièrement difficile à instaurer dans un petit pays sans diversité économique, elle est plus facile à supporter dans une grande économie diversifiée. Et on peut même affirmer que l’autarcie à l’échelle d’un continent riche peut compter aujourd’hui sur quelques défenseurs (15) ». Ils estiment non sans raison que « la France possède tous les moyens technologiques et humains de l’autarcie. Elle est même pratiquement un des seuls pays au monde à pouvoir organiser volontairement son propre embargo ! (16) ». « L’écologie extrême […] est notre dernière chance de discipline collective et d’argumentation des interdits, insiste Rodolphe Crevelle (17) ».
Il manque encore à la décroissance tout une dimension politique et stratégique. De nombreux décroissants raisonnent toujours à l’échelle de leur potager dans le « village global » interconnecté alors que la raréfaction croissante des ressources inciterait à envisager au contraire une société fermée, qu’elle soit nationale ou bien continentale dans le cadre de l’« Europe cuirassée » chère à Maurice Bardèche. En effet, « c’est […] bien une société de rupture qu’il faut ambitionner, annonce l’anarcho-royaliste français Rodolphe Crevelle, quitte à mépriser tous les clivages politiques antérieurs, quitte à paraître donquichottesque ou ridicule, ou rêveur, ou utopique… (13) ». Nourris par les traductions anglaises des écrits de l’écologiste radical finlandais Pentti Linkola dans lesquels se conjuguent écologie, décroissance et puissance militaire, Rodolphe Crevelle et son équipe du Lys Noir soutiennent une vision singulière de l’« écolo-décroissance ». « La préservation de l’Homme ancien “ dans un seul pays d’abord ”, ouvre la perspective d’un isolat forteresse assiégé parce que celui-ci constituera le mauvais exemple, le mouton noir du monde, un démenti à la “ fête ” globale planétaire (14). » Certes, « il faut […] convenir que l’autarcie est une question d’échelle. Elle est particulièrement difficile à instaurer dans un petit pays sans diversité économique, elle est plus facile à supporter dans une grande économie diversifiée. Et on peut même affirmer que l’autarcie à l’échelle d’un continent riche peut compter aujourd’hui sur quelques défenseurs (15) ». Ils estiment non sans raison que « la France possède tous les moyens technologiques et humains de l’autarcie. Elle est même pratiquement un des seuls pays au monde à pouvoir organiser volontairement son propre embargo ! (16) ». « L’écologie extrême […] est notre dernière chance de discipline collective et d’argumentation des interdits, insiste Rodolphe Crevelle (17) ».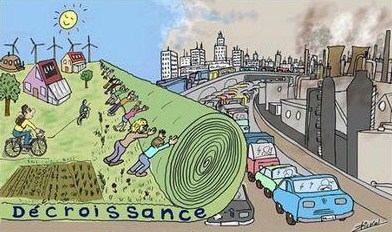 Avec des frontières réhabilitées, sans la moindre porosité et grâce à des gardiens vigilants, dénués de remords, la société fermée décroissante adopterait vite la notion de puissance afin de tenir à distance un voisinage plus qu’avide de s’emparer de ses terres et de ses biens. Elle pratiquerait une nécessaire auto-suffisance tant alimentaire qu’énergétique. Mais cette voie vers l’autarcie salutaire risque de ne pas aboutir si la population n’entreprend pas d’elle-même une révolution culturelle et un renversement complet des consciences. « Outre l’autarcie économique européenne, il faudrait mieux encore parler d’autarcie technique, d’auto-isolement sanitaire; d’un refus de courir plus loin et plus vite vers le précipice, vers le monde de “ science-fiction contemporaine ” qui s’est installé sur toute la planète dans la plus parfaite soumission des gauchistes et des conservateurs (18). » L’auto-subsistance vivrière deviendra un atout considérable en périodes de troubles politiques et socio-économiques. « Tant que la perspective d’un soulèvement populaire signifiera pénurie certaine de soins, de nourriture ou d’énergie, il n’y aura pas de mouvement de masse décidé, prévient le Comité invisible. En d’autres termes : il nous faut reprendre un travail méticuleux d’enquête. Il nous faut aller à la rencontre, dans tous les secteurs, sur tous les territoires où nous habitons, de ceux qui disposent des savoirs techniques stratégiques (19). »
Avec des frontières réhabilitées, sans la moindre porosité et grâce à des gardiens vigilants, dénués de remords, la société fermée décroissante adopterait vite la notion de puissance afin de tenir à distance un voisinage plus qu’avide de s’emparer de ses terres et de ses biens. Elle pratiquerait une nécessaire auto-suffisance tant alimentaire qu’énergétique. Mais cette voie vers l’autarcie salutaire risque de ne pas aboutir si la population n’entreprend pas d’elle-même une révolution culturelle et un renversement complet des consciences. « Outre l’autarcie économique européenne, il faudrait mieux encore parler d’autarcie technique, d’auto-isolement sanitaire; d’un refus de courir plus loin et plus vite vers le précipice, vers le monde de “ science-fiction contemporaine ” qui s’est installé sur toute la planète dans la plus parfaite soumission des gauchistes et des conservateurs (18). » L’auto-subsistance vivrière deviendra un atout considérable en périodes de troubles politiques et socio-économiques. « Tant que la perspective d’un soulèvement populaire signifiera pénurie certaine de soins, de nourriture ou d’énergie, il n’y aura pas de mouvement de masse décidé, prévient le Comité invisible. En d’autres termes : il nous faut reprendre un travail méticuleux d’enquête. Il nous faut aller à la rencontre, dans tous les secteurs, sur tous les territoires où nous habitons, de ceux qui disposent des savoirs techniques stratégiques (19). »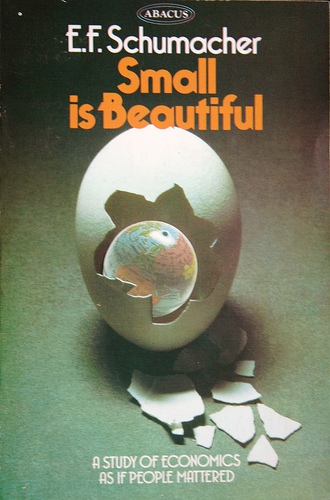 Pour une question d’efficacité, une économie élaborée sur des mesures décroissantes ne peut être que d’échelle nationale ou continentale en étroit lien organique avec les niveaux (bio)régional et local. Il ne faut pas omettre que « le local n’est pas un microcosme fermé, mais un nœud dans un réseau de relations transversales vertueuses et solidaires, en vue d’expérimenter des pratiques de renforcement démocratique (dont les budgets participatifs) qui permettent de résister à la domination libérale (25) ». On réactualise une pratique politique traditionnelle : « L’autorité en haut, les libertés en bas ». Faut-il pour autant valoriser le local ? Non, répond le Comité invisible pour qui le local « est une contraction du global (26) ». Pourquoi cette surprenante défiance ? Par crainte de l’enracinement barrésien ? Par indécrottable altermondialisme ? « Il y a tout à perdre à revendiquer le local contre le global, soutient l’auteur (collectif ?) d’À nos amis. Le local n’est pas la rassurante alternative à la globalisation, mais son produit universel : avant que le monde ne soit globalisé, le lieu où j’habite était seulement mon territoire familier, je ne le connaissais pas comme “ local ”, le local n’est que l’envers du global, son résidu, sa sécrétion, et non ce qui peut le faire éclater (27). »
Pour une question d’efficacité, une économie élaborée sur des mesures décroissantes ne peut être que d’échelle nationale ou continentale en étroit lien organique avec les niveaux (bio)régional et local. Il ne faut pas omettre que « le local n’est pas un microcosme fermé, mais un nœud dans un réseau de relations transversales vertueuses et solidaires, en vue d’expérimenter des pratiques de renforcement démocratique (dont les budgets participatifs) qui permettent de résister à la domination libérale (25) ». On réactualise une pratique politique traditionnelle : « L’autorité en haut, les libertés en bas ». Faut-il pour autant valoriser le local ? Non, répond le Comité invisible pour qui le local « est une contraction du global (26) ». Pourquoi cette surprenante défiance ? Par crainte de l’enracinement barrésien ? Par indécrottable altermondialisme ? « Il y a tout à perdre à revendiquer le local contre le global, soutient l’auteur (collectif ?) d’À nos amis. Le local n’est pas la rassurante alternative à la globalisation, mais son produit universel : avant que le monde ne soit globalisé, le lieu où j’habite était seulement mon territoire familier, je ne le connaissais pas comme “ local ”, le local n’est que l’envers du global, son résidu, sa sécrétion, et non ce qui peut le faire éclater (27). »
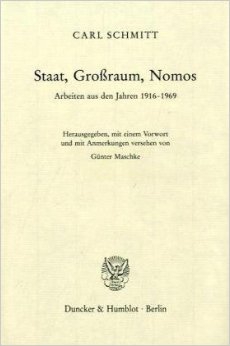 Si può comunque affermare con una certa sicurezza che attorno alla fine degli anni ’20 le tesi schmittiane subiscano un’evoluzione da una prima fase incentrata sulla “decisione” a una seconda che volge invece agli “ordini concreti”, per una concezione del diritto più ancorata alla realtà e svincolata non solo dall’eterea astrattezza del normativismo, ma pure dallo “stato d’eccezione”, assenza originaria da cui il diritto stesso nasce restando però co-implicato in essa.
Si può comunque affermare con una certa sicurezza che attorno alla fine degli anni ’20 le tesi schmittiane subiscano un’evoluzione da una prima fase incentrata sulla “decisione” a una seconda che volge invece agli “ordini concreti”, per una concezione del diritto più ancorata alla realtà e svincolata non solo dall’eterea astrattezza del normativismo, ma pure dallo “stato d’eccezione”, assenza originaria da cui il diritto stesso nasce restando però co-implicato in essa. Lo spazio, cardine di quest’impianto teorico, viene analizzato nella sua evoluzione storico-filosofica e con riferimenti alle rivoluzioni che hanno cambiato radicalmente la prospettiva dell’uomo. La modernità si apre infatti con la scoperta del Nuovo Mondo e dello spazio vuoto d’oltreoceano, che disorienta gli europei e li sollecita ad appropriarsi del continente, dividendosi terre sterminate mediante linee di organizzazione e spartizione. Queste rispondono al bisogno di concretezza e si manifestano in un sistema di limiti e misure da inserire in uno spazio considerato ancora come dimensione vuota. È con la nuova rivoluzione spaziale realizzata dal progresso tecnico – nato in Inghilterra con la rivoluzione industriale – che l’idea di spazio esce profondamente modificata, ridotta a dimensione “liscia” e uniforme alla mercé delle invenzioni prodotte dall’uomo quali «elettricità, aviazione e radiotelegrafia», che «produssero un tale sovvertimento di tutte le idee di spazio da portare chiaramente (…) a una seconda rivoluzione spaziale» (Ivi, p.106). Schmitt si oppone a questo cambio di rotta in senso post-classico e, citando la critica heideggeriana alla res extensa, riprende l’idea che è lo spazio ad essere nel mondo e non viceversa. L’originarietà dello spazio, tuttavia, assume in lui connotazioni meno teoretiche, allontanandosi dalla dimensione di “datità” naturale per prendere le forme di determinazione e funzione del “politico”. In questo contesto il rapporto tra idea ed eccezione, ancora minacciato dalla “potenza del Niente” nella produzione precedente, si arricchisce di determinazioni spaziali concrete, facendosi nomos e cogliendo il nesso ontologico che collega giustizia e diritto alla Terra, concetto cardine de Il nomos della terra, che rappresenta per certi versi una nostalgica apologia dello ius publicum europaeum e delle sue storiche conquiste. In quest’opera infatti Schmitt si sofferma nuovamente sulla contrapposizione terra/mare, analizzata stavolta non nei termini polemici ed oppositivi di Terra e mare
Lo spazio, cardine di quest’impianto teorico, viene analizzato nella sua evoluzione storico-filosofica e con riferimenti alle rivoluzioni che hanno cambiato radicalmente la prospettiva dell’uomo. La modernità si apre infatti con la scoperta del Nuovo Mondo e dello spazio vuoto d’oltreoceano, che disorienta gli europei e li sollecita ad appropriarsi del continente, dividendosi terre sterminate mediante linee di organizzazione e spartizione. Queste rispondono al bisogno di concretezza e si manifestano in un sistema di limiti e misure da inserire in uno spazio considerato ancora come dimensione vuota. È con la nuova rivoluzione spaziale realizzata dal progresso tecnico – nato in Inghilterra con la rivoluzione industriale – che l’idea di spazio esce profondamente modificata, ridotta a dimensione “liscia” e uniforme alla mercé delle invenzioni prodotte dall’uomo quali «elettricità, aviazione e radiotelegrafia», che «produssero un tale sovvertimento di tutte le idee di spazio da portare chiaramente (…) a una seconda rivoluzione spaziale» (Ivi, p.106). Schmitt si oppone a questo cambio di rotta in senso post-classico e, citando la critica heideggeriana alla res extensa, riprende l’idea che è lo spazio ad essere nel mondo e non viceversa. L’originarietà dello spazio, tuttavia, assume in lui connotazioni meno teoretiche, allontanandosi dalla dimensione di “datità” naturale per prendere le forme di determinazione e funzione del “politico”. In questo contesto il rapporto tra idea ed eccezione, ancora minacciato dalla “potenza del Niente” nella produzione precedente, si arricchisce di determinazioni spaziali concrete, facendosi nomos e cogliendo il nesso ontologico che collega giustizia e diritto alla Terra, concetto cardine de Il nomos della terra, che rappresenta per certi versi una nostalgica apologia dello ius publicum europaeum e delle sue storiche conquiste. In quest’opera infatti Schmitt si sofferma nuovamente sulla contrapposizione terra/mare, analizzata stavolta non nei termini polemici ed oppositivi di Terra e mare
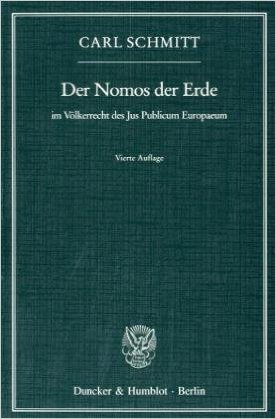 La complessa produzione di Carl Schmitt, tanto affascinante quanto labirintica, ha dato un contributo fondamentale alla comprensione del nichilismo e ai processi di secolarizzazione e neutralizzazione che l’hanno provocato. Spinto da un’inesorabile volontà di esorcizzare la crisi e la negatività in cui stava precipitando la decadente Europa d’inizio Novecento, il giurista tedesco si confronta impavidamente con la “potenza del Niente” – esperienza cruciale per la comprensione di quell’epoca e per restare dentro alla filosofia, come ammonivano Jünger ed Heidegger in Oltre la linea –, tentando di opporre all’horror vacui soluzioni di volta in volta sempre più solide, concrete ed elementari, nel corso di un itinerario intellettuale lungo, tortuoso e per certi aspetti contraddittorio.
La complessa produzione di Carl Schmitt, tanto affascinante quanto labirintica, ha dato un contributo fondamentale alla comprensione del nichilismo e ai processi di secolarizzazione e neutralizzazione che l’hanno provocato. Spinto da un’inesorabile volontà di esorcizzare la crisi e la negatività in cui stava precipitando la decadente Europa d’inizio Novecento, il giurista tedesco si confronta impavidamente con la “potenza del Niente” – esperienza cruciale per la comprensione di quell’epoca e per restare dentro alla filosofia, come ammonivano Jünger ed Heidegger in Oltre la linea –, tentando di opporre all’horror vacui soluzioni di volta in volta sempre più solide, concrete ed elementari, nel corso di un itinerario intellettuale lungo, tortuoso e per certi aspetti contraddittorio. Di qui la necessità avvertita dal giurista esperto del mondo classico di recuperare l’etimologia autentica del termine νεμειν, che si articola in tre significati: “prendere, conquistare” (da cui i concetti di Landnahme e Seenahme, sviluppati in Terra e mare nel ’42); “dividere, spartire”, ad indicare la suddivisione del terreno e la conseguente nascita di un ordinamento proprietario su di esso; “pascolare”, quindi utilizzare, valorizzare, consumare. Soffermandosi sulla genesi della parola nomos Schmitt vuole restituirle la “forza e grandezza primitiva” salvandola dalla cattiva interpretazione datale dai contemporanei, che l’hanno “ridotta a designare, in maniera generica e priva di sostanza, ogni tipo di regolamentazione o disposizione normativistica”, come afferma polemicamente ne Il nomos della terra, pubblicato nel 1950 e summa del suo pensiero giuridico e politico. L’uso linguistico di “un’epoca decadente che non sa più collegarsi alle proprie origini” funzionalizza il nomos alla legge, non distinguendo tra diritto fondamentale e atti di posizione e facendo scomparire il legame con l’atto costitutivo dell’ordinamento spaziale.
Di qui la necessità avvertita dal giurista esperto del mondo classico di recuperare l’etimologia autentica del termine νεμειν, che si articola in tre significati: “prendere, conquistare” (da cui i concetti di Landnahme e Seenahme, sviluppati in Terra e mare nel ’42); “dividere, spartire”, ad indicare la suddivisione del terreno e la conseguente nascita di un ordinamento proprietario su di esso; “pascolare”, quindi utilizzare, valorizzare, consumare. Soffermandosi sulla genesi della parola nomos Schmitt vuole restituirle la “forza e grandezza primitiva” salvandola dalla cattiva interpretazione datale dai contemporanei, che l’hanno “ridotta a designare, in maniera generica e priva di sostanza, ogni tipo di regolamentazione o disposizione normativistica”, come afferma polemicamente ne Il nomos della terra, pubblicato nel 1950 e summa del suo pensiero giuridico e politico. L’uso linguistico di “un’epoca decadente che non sa più collegarsi alle proprie origini” funzionalizza il nomos alla legge, non distinguendo tra diritto fondamentale e atti di posizione e facendo scomparire il legame con l’atto costitutivo dell’ordinamento spaziale.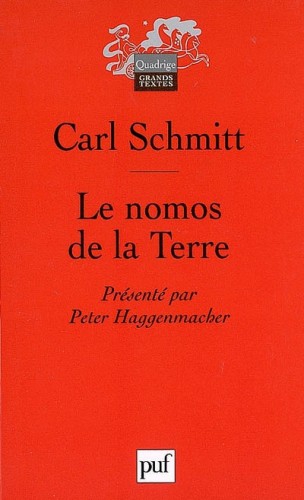 L’irrazionalità della guerra viene dunque confinata nelle amity lines del mare mentre sul suolo continentale, a mo’ di razionalizzazione effettiva del sacrificio, resta la guerre en forme tra Stati che si riconoscono reciprocamente come sovrani e che non mirano all’annichilimento o alla criminalizzazione del nemico. Una delle maggiori conquiste del diritto pubblico europeo è stata infatti la limitazione della guerra (Hegung des Krieges) e la trasformazione dal bellum iustum delle guerre civili di religione in conflitti “giusti” tra pari, tra hostes aequaliter iusti. Quest’atto di contenimento non è stato frutto delle ideologie razionalistiche, bensì della particolare condizione di equilibrio di cui l’Europa moderna ha goduto fino al 1914. Un assetto fondato non solo sulla dialettica vecchio/nuovo mondo – strumentalizzata da Schmitt, secondo alcuni, per difendere l’imperialismo e il colonialismo europeo -, ma anche sul rapporto tra terraferma e libertà del mare che ha fatto in primis le fortune dell’Inghilterra, che ha scelto di diventarne “figlia” trasformando la propria essenza storico-politica ed arrivando a dominare lo spazio liscio e uniforme.
L’irrazionalità della guerra viene dunque confinata nelle amity lines del mare mentre sul suolo continentale, a mo’ di razionalizzazione effettiva del sacrificio, resta la guerre en forme tra Stati che si riconoscono reciprocamente come sovrani e che non mirano all’annichilimento o alla criminalizzazione del nemico. Una delle maggiori conquiste del diritto pubblico europeo è stata infatti la limitazione della guerra (Hegung des Krieges) e la trasformazione dal bellum iustum delle guerre civili di religione in conflitti “giusti” tra pari, tra hostes aequaliter iusti. Quest’atto di contenimento non è stato frutto delle ideologie razionalistiche, bensì della particolare condizione di equilibrio di cui l’Europa moderna ha goduto fino al 1914. Un assetto fondato non solo sulla dialettica vecchio/nuovo mondo – strumentalizzata da Schmitt, secondo alcuni, per difendere l’imperialismo e il colonialismo europeo -, ma anche sul rapporto tra terraferma e libertà del mare che ha fatto in primis le fortune dell’Inghilterra, che ha scelto di diventarne “figlia” trasformando la propria essenza storico-politica ed arrivando a dominare lo spazio liscio e uniforme.

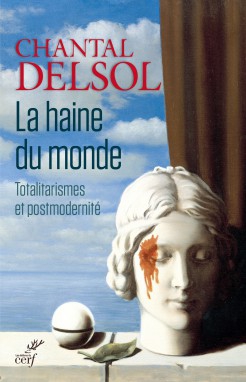 « Éduque- les, si tu peux » : c’est par ces mots de Marc-Aurèle que Chantal Delsol concluait son ouvrage sur le populisme, enjoignant nos gouvernants au respect de l’enracinement, et le peuple à élever prudemment son regard. La Haine du Monde, son dernier essai, poursuit cette réflexion sur la modernité tardive, nous éduquant à notre tour.
« Éduque- les, si tu peux » : c’est par ces mots de Marc-Aurèle que Chantal Delsol concluait son ouvrage sur le populisme, enjoignant nos gouvernants au respect de l’enracinement, et le peuple à élever prudemment son regard. La Haine du Monde, son dernier essai, poursuit cette réflexion sur la modernité tardive, nous éduquant à notre tour.
 Seine analytisch eingehendste Betrachtung der politischen Nachkriegsordnung ist der Vortrag „Die Ordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg“, den Schmitt 1962 in Madrid hielt und bei Lebzeiten nur in einer spanischen Fassung publizierte. Nur hier verknüpft er seine Überlegungen auch mit der Entwicklung der UNO. Sein Ausgangspunkt ist die Dekolonialisierung und der „Antikolonialismus“ nach 1945, den Schmitt als „Propaganda“ und „Reflex“ der Zerstörung der alten, europäischen Raumordnung betrachtet. Diese „anti-europäische Propaganda“ begann „leider“, betont Schmitt, als „inner-europäische Kampagne“ (SGN 594). Gegenstück sei der „Nomos des Kosmos“ (SGN 595): „Der Anti-Kolonialismus ist nichts anderes als die Liquidierung einer historischen Vergangenheit auf Kosten der europäischen Nationen. Die Eroberung des Kosmos hingegen ist pure Zukunft“ (SGN 596), schreibt Schmitt. Dazwischen sei der gegenwärtige „Nomos der Erde“ zu suchen. Schmitt nähert sich ihm mit Überlegungen zum Kalten Krieg als „Teil des revolutionären Krieges“. Er rekapituliert hier Überlegungen zur Wiederkehr der Lehre vom „gerechten Krieg“. Deutlicher benennt er nun aber „drei Stadien des Kalten Krieges“ und kennzeichnet die Gegenwart dabei durch ein „pluralistisches Stadium“, in dem sich eine „erstaunliche Zahl neuer afrikanischer und asiatischer Staaten“ (SGN 602) der dualistischen Struktur des Ost-West-Gegensatzes nicht mehr fügten und die UNO zum Forum der politischen Organisation einer „dritten Front“ nutzten. In der „Theorie des Partisanen“ nennt er an dieser Stelle dann China und Maos „pluralistische Vorstellung eines neuen Nomos der Erde“ (TP 62).
Seine analytisch eingehendste Betrachtung der politischen Nachkriegsordnung ist der Vortrag „Die Ordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg“, den Schmitt 1962 in Madrid hielt und bei Lebzeiten nur in einer spanischen Fassung publizierte. Nur hier verknüpft er seine Überlegungen auch mit der Entwicklung der UNO. Sein Ausgangspunkt ist die Dekolonialisierung und der „Antikolonialismus“ nach 1945, den Schmitt als „Propaganda“ und „Reflex“ der Zerstörung der alten, europäischen Raumordnung betrachtet. Diese „anti-europäische Propaganda“ begann „leider“, betont Schmitt, als „inner-europäische Kampagne“ (SGN 594). Gegenstück sei der „Nomos des Kosmos“ (SGN 595): „Der Anti-Kolonialismus ist nichts anderes als die Liquidierung einer historischen Vergangenheit auf Kosten der europäischen Nationen. Die Eroberung des Kosmos hingegen ist pure Zukunft“ (SGN 596), schreibt Schmitt. Dazwischen sei der gegenwärtige „Nomos der Erde“ zu suchen. Schmitt nähert sich ihm mit Überlegungen zum Kalten Krieg als „Teil des revolutionären Krieges“. Er rekapituliert hier Überlegungen zur Wiederkehr der Lehre vom „gerechten Krieg“. Deutlicher benennt er nun aber „drei Stadien des Kalten Krieges“ und kennzeichnet die Gegenwart dabei durch ein „pluralistisches Stadium“, in dem sich eine „erstaunliche Zahl neuer afrikanischer und asiatischer Staaten“ (SGN 602) der dualistischen Struktur des Ost-West-Gegensatzes nicht mehr fügten und die UNO zum Forum der politischen Organisation einer „dritten Front“ nutzten. In der „Theorie des Partisanen“ nennt er an dieser Stelle dann China und Maos „pluralistische Vorstellung eines neuen Nomos der Erde“ (TP 62). Kirchheimer, Neumann und Fraenkel waren Schmitt nicht unkritisch gefolgt. Sie hatten ihn politisch wie rechtstheoretisch abgeklärt rezipiert, so dass Berührungsscheu nach 1949 nicht nötig schien. Aus dem „Fall“ Schmitt ließ sich deshalb auch kein „Fall“ Habermas machen. Der von Ellen Kennedy33 formulierte Verdacht lautete dennoch vereinfacht gesagt, dass Habermas von seinen frühen politischen Schriften bis in die Deutung der „Friedensbewegung“ der 80er Jahre hinein um den Preis ideologischer Verblendung von Schmitt beeinflusst war. Habermas’ Replik „Die Schrecken der Autonomie“ grenzte den eigenen, kommunikationstheoretisch entwickelten Begriff der „normativen Grundlagen der Demokratie“ von Schmitt ab. Demnach hält Habermas nicht Schmitts Liberalismuskritik für fruchtbar, sondern dessen Überlegungen zu den normativen Grundlagen der Demokratie. Er schreibt:
Kirchheimer, Neumann und Fraenkel waren Schmitt nicht unkritisch gefolgt. Sie hatten ihn politisch wie rechtstheoretisch abgeklärt rezipiert, so dass Berührungsscheu nach 1949 nicht nötig schien. Aus dem „Fall“ Schmitt ließ sich deshalb auch kein „Fall“ Habermas machen. Der von Ellen Kennedy33 formulierte Verdacht lautete dennoch vereinfacht gesagt, dass Habermas von seinen frühen politischen Schriften bis in die Deutung der „Friedensbewegung“ der 80er Jahre hinein um den Preis ideologischer Verblendung von Schmitt beeinflusst war. Habermas’ Replik „Die Schrecken der Autonomie“ grenzte den eigenen, kommunikationstheoretisch entwickelten Begriff der „normativen Grundlagen der Demokratie“ von Schmitt ab. Demnach hält Habermas nicht Schmitts Liberalismuskritik für fruchtbar, sondern dessen Überlegungen zu den normativen Grundlagen der Demokratie. Er schreibt:

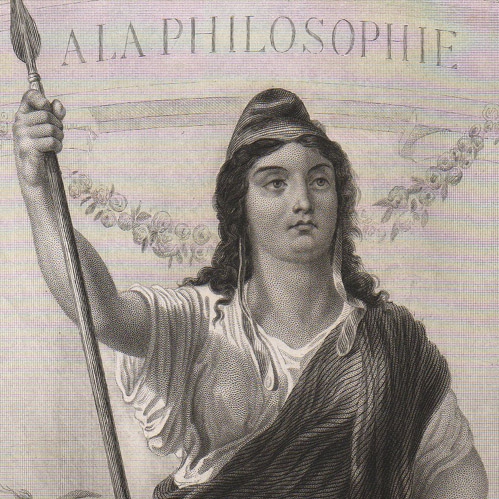

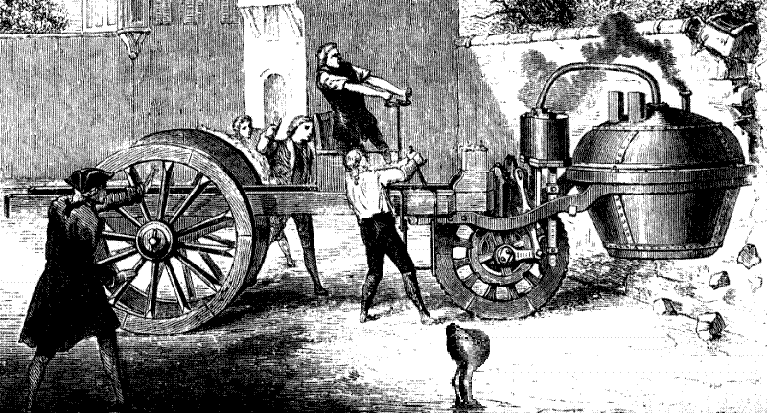


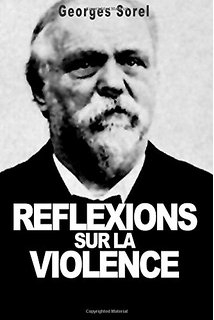
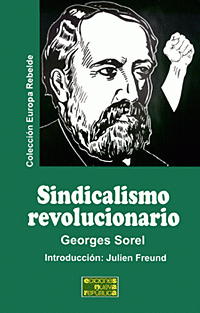 Sorels Einstehen für die Gewalt ergibt sich daraus, dass er den moralischen Zustand der bürgerlichen Gesellschaft haargenau getroffen hat: die bürgerliche Gesellschaft ist „aus den Fugen“. Der Bourgeois, ehemals ein energischer Kapitalist, ist zum schwächlichen Humanisten und Philanthropen degeneriert. Ihn zeichnen nicht mehr der Kampfgeist und der übersprühende Machtwille einer aufblühenden, sondern das Ruhebedürfnis und die Albernheit einer untergehenden Klasse aus: der Industriekapitän und der heroische Produzent von einst sind einer „gesittigten Aristokratie“ gewichen. Diese wünscht nur noch, in Frieden zu leben und sogar in Ruhe zu sterben.
Sorels Einstehen für die Gewalt ergibt sich daraus, dass er den moralischen Zustand der bürgerlichen Gesellschaft haargenau getroffen hat: die bürgerliche Gesellschaft ist „aus den Fugen“. Der Bourgeois, ehemals ein energischer Kapitalist, ist zum schwächlichen Humanisten und Philanthropen degeneriert. Ihn zeichnen nicht mehr der Kampfgeist und der übersprühende Machtwille einer aufblühenden, sondern das Ruhebedürfnis und die Albernheit einer untergehenden Klasse aus: der Industriekapitän und der heroische Produzent von einst sind einer „gesittigten Aristokratie“ gewichen. Diese wünscht nur noch, in Frieden zu leben und sogar in Ruhe zu sterben.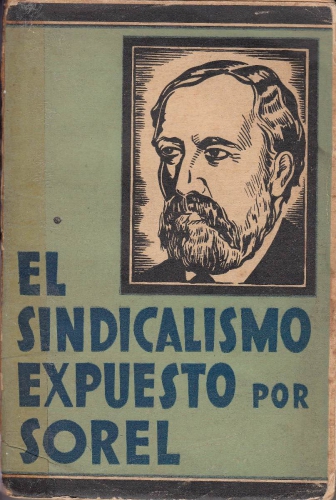



 La démocratie s'est développée en inventant de nouveaux dispositifs plus complexes. Un parcours historique se fait alors de la Grèce, de Rome, du trust médiéval, vers la révolution industrielle, jusqu'à nos jours. Chaque fois, un dispositif de substitution est conçu dont les perturbations et les débordements sont admis pour permettre des solutions décisionnelles. C'est par la perturbation contrôlée progressivement que le système s'installe et se fait admettre. Système délicat à manier, instable, accentuant les inégalités mais permettant une permanence : on se confie paradoxalement à ce qui trouble l'ordre public, pour développer et complexifier cette organisation politique. Situation très curieuse.
La démocratie s'est développée en inventant de nouveaux dispositifs plus complexes. Un parcours historique se fait alors de la Grèce, de Rome, du trust médiéval, vers la révolution industrielle, jusqu'à nos jours. Chaque fois, un dispositif de substitution est conçu dont les perturbations et les débordements sont admis pour permettre des solutions décisionnelles. C'est par la perturbation contrôlée progressivement que le système s'installe et se fait admettre. Système délicat à manier, instable, accentuant les inégalités mais permettant une permanence : on se confie paradoxalement à ce qui trouble l'ordre public, pour développer et complexifier cette organisation politique. Situation très curieuse.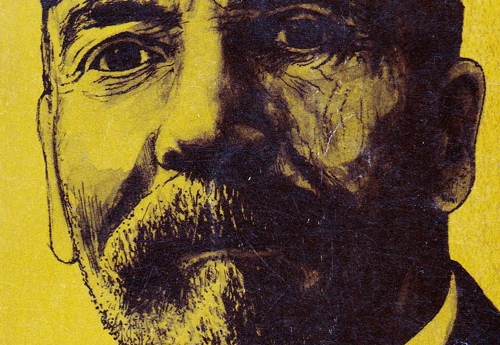
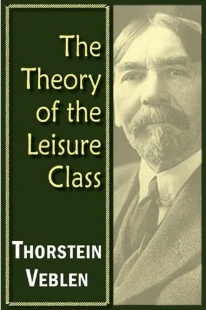 Et pourtant, face aux dérives et aux échecs du néo-libéralisme, ses écrits, et notamment The Theory of the Leisure Class (1899), analyse critique de la vie sociale des hommes d'affaires, le placent parmi les auteurs qui méritent d'être redécouvert. Il a lors de son enseignement un rôle stimulant pour l'élaboration de notions fondamentales telles que celle de relative deprivation et par son ébauche des théories modernes de l'action sociale. Il écrit également dans sa sociologie critique du capitalisme d'autres ouvrages tels que Theory of Business Enterprise (1904), The Instinct of Workmanship (1914) et The Engineer and the price System (1921). (Daniel DERIVRY).
Et pourtant, face aux dérives et aux échecs du néo-libéralisme, ses écrits, et notamment The Theory of the Leisure Class (1899), analyse critique de la vie sociale des hommes d'affaires, le placent parmi les auteurs qui méritent d'être redécouvert. Il a lors de son enseignement un rôle stimulant pour l'élaboration de notions fondamentales telles que celle de relative deprivation et par son ébauche des théories modernes de l'action sociale. Il écrit également dans sa sociologie critique du capitalisme d'autres ouvrages tels que Theory of Business Enterprise (1904), The Instinct of Workmanship (1914) et The Engineer and the price System (1921). (Daniel DERIVRY).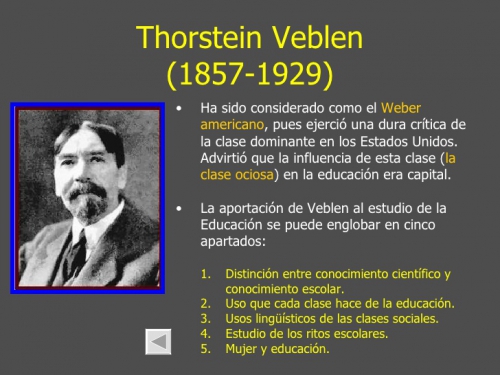
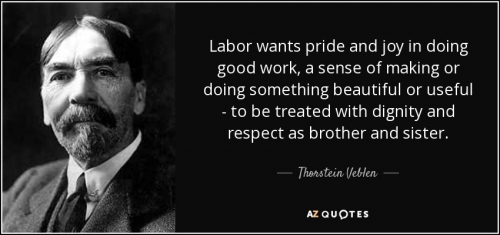



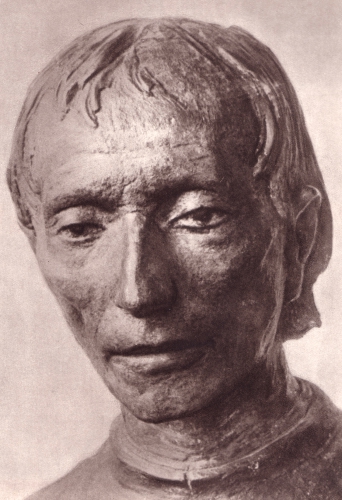

 Nous vivons un moment historique déterminant. Le déni de réalité est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. L’analyse qui précède est tragique mais juste. La République-Système a engendré volontairement un modèle de société ouverte et mélangée qui est sur le point d’exploser (dans le meilleur des cas) ou de dissoudre les peuples. Il n’y a pas d’autre alternative. Devons-nous rester dans le cadre défini par ce modèle ? Mais quel sera alors l’avenir de nos enfants ? Seront-ils des clones ou des êtres de misères à l’existence incertaine ? Ne devons-nous pas plutôt sortir du cadre pour imaginer une troisième voie entre la guerre civile et la fin de notre humanité ?
Nous vivons un moment historique déterminant. Le déni de réalité est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. L’analyse qui précède est tragique mais juste. La République-Système a engendré volontairement un modèle de société ouverte et mélangée qui est sur le point d’exploser (dans le meilleur des cas) ou de dissoudre les peuples. Il n’y a pas d’autre alternative. Devons-nous rester dans le cadre défini par ce modèle ? Mais quel sera alors l’avenir de nos enfants ? Seront-ils des clones ou des êtres de misères à l’existence incertaine ? Ne devons-nous pas plutôt sortir du cadre pour imaginer une troisième voie entre la guerre civile et la fin de notre humanité ?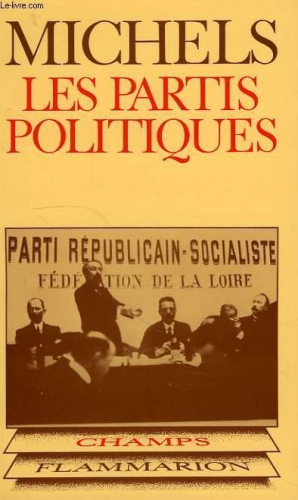 Lu Les partis politiques - essai sur les tendances oligarchiques des démocraties.
Lu Les partis politiques - essai sur les tendances oligarchiques des démocraties.  « En général, les chef ne tiennent pas les masses en haute estime. [...] Les chefs ouvriers avouent parfois eux-mêmes, avec une sincérité qui frise le cynisme, leur supériorité réelle sur les milices confiées à leur commandement et leur ferme propos de ne pas admettre que celles-ci leur imposent une ligne de conduite. »
« En général, les chef ne tiennent pas les masses en haute estime. [...] Les chefs ouvriers avouent parfois eux-mêmes, avec une sincérité qui frise le cynisme, leur supériorité réelle sur les milices confiées à leur commandement et leur ferme propos de ne pas admettre que celles-ci leur imposent une ligne de conduite. » « Il est certain que pour défendre ses privilèges avec ténacité et persévérance, la classe privilégiée doit posséder, entre autres qualités, une indomptable énergie qui se concilie facilement avec la cruauté et l'absence de scrupules, mais se montre particulièrement efficace lorsqu'elle découle de la ferme conviction qu'on a pour soi le bon droit. »
« Il est certain que pour défendre ses privilèges avec ténacité et persévérance, la classe privilégiée doit posséder, entre autres qualités, une indomptable énergie qui se concilie facilement avec la cruauté et l'absence de scrupules, mais se montre particulièrement efficace lorsqu'elle découle de la ferme conviction qu'on a pour soi le bon droit. »